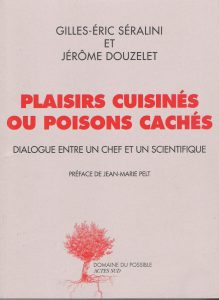 A La Griotte, au soir du jeudi 23 octobre dernier, la grande table était mise et le menu copieux. Voyez plutôt : 300 convives pour trois heures d’agapes. Les maîtres queux ? Jérôme Douzelet et Gilles-Eric Séralini. Le premier est chef cuisinier à Barjac (Gard) et met un point d’honneur à façonner des plats de haute qualité alimentaire et gustative à partir de produits locaux qu’il a lui-même sélectionnés. Le second est professeur et chercheur à l’université de Caen (Calvados), spécialiste des OGM et des pesticides ; il est connu pour ses expériences récentes établissant un lien entre un herbicide majeur, un OGM, et l’apparition de tumeurs, de maladies du foie et des reins. Tous deux ont décidé d’unir leurs voix pour révéler comment s’établit la malhonnêteté de l’évaluation des produits chimiques dans la nourriture. Voilà le menu, consistant et roboratif. Alors à table !
A La Griotte, au soir du jeudi 23 octobre dernier, la grande table était mise et le menu copieux. Voyez plutôt : 300 convives pour trois heures d’agapes. Les maîtres queux ? Jérôme Douzelet et Gilles-Eric Séralini. Le premier est chef cuisinier à Barjac (Gard) et met un point d’honneur à façonner des plats de haute qualité alimentaire et gustative à partir de produits locaux qu’il a lui-même sélectionnés. Le second est professeur et chercheur à l’université de Caen (Calvados), spécialiste des OGM et des pesticides ; il est connu pour ses expériences récentes établissant un lien entre un herbicide majeur, un OGM, et l’apparition de tumeurs, de maladies du foie et des reins. Tous deux ont décidé d’unir leurs voix pour révéler comment s’établit la malhonnêteté de l’évaluation des produits chimiques dans la nourriture. Voilà le menu, consistant et roboratif. Alors à table !
En guise d’amuse-gueules, Jérôme Douzelet s’épanche : « La cuisine est partage et don, elle est un acte d’amour. Un chef cuisinier le sait bien : pour ses convives, il se consacre au choix délicat et soucieux des produits ; il élabore des recettes techniques et parfois complexes, ou tout simplement il valorise le goût naturel d’un ingrédient. » La diversité des ingrédients que la nature lui propose, et la biodiversité en général, sont deux fondements sur lesquels prend appui son travail. Manger est un acte qui touche notre intimité car en mangeant nous faisons pénétrer des produits étrangers dans notre corps. Il est nécessaire de s’assurer de la qualité de ces produits.
Pour lui, créer une recette est un jeu ; il s’agit d’abord de humer les divers parfums existant dans la nature pour développer une mémoire visuelle et gustative ; mais la véritable maîtrise du cuisinier s’exprime dans son art d’éveiller les cinq sens de ses convives.
On commence à découvrir un plat avec ses yeux, on en jauge les couleurs, les formes et les volumes ; peu à peu, la présentation des plats investit la troisième dimension. Cette verticalité permet des présentations originales qui interpellent le convive et stimule, chez lui, « la future jouissance du goût. »
Vient ensuite le parfum des ingrédients travaillés en cuisine et ressenti à table : « il est souvent exalté par la température. » Ainsi « l’odorat précède et complète le goût, comme le toucher le fera pour la texture des ingrédients avec la fourchette, les lèvres, les dents, le palais et la langue, les doigts » parfois.
L’ouïe se surajoute à ce concert des sens : la croûte de pain croustille et le sucre caramélisé d’une crème brûlée se craquelle avec bonheur telles des percussions rythmant la mélodie qui progressivement enveloppe le convive. « Au final, la diversité de nos sens et leurs stimuli révèlent un autre aspect de la biodiversité, vécue par l’alimentation. »
Gilles-Eric Séralini, en écho, analyse ce qui se passe dans le cerveau du convive : un goût n’est perçu que dans la mesure où sont stimulés des récepteurs spécifiques situés sur la langue et dans le bulbe olfactif d’une part et que, d’autre part, le signal électrique de la toute première perception visuelle d’un élément stimule déjà les sécrétions d’hormones digestives (où l’on perçoit mieux l’importance du dressage des plats et de la mise en scène du couvert pour attiser l’appétit et faire saliver). Et de poursuivre en expliquant que ce kaléidoscope de saveurs, d’odeurs, de textures et de couleurs, va progressivement, sur des mois et des années, provoquer le développement de récepteurs au niveau des organes des sens que sont, par exemple, la langue ou le nez, amplifiant la sensibilité du convive et concourant à son éducation culinaire. Il s’agit d’un véritable « apprentissage du goût par l’expérience. »
Et Jérôme Douzelet de rebondir : « soumis quotidiennement aux boissons gazeuses dont le sucre est obtenu à partir d’amidon de maïs, aux bonbons faits de gélatine, aux hamburgers pleins d’additifs ou à du jambon industriel, les enfants ne développeront pas leurs sens du goût et de l’odeur. » Leurs repas sont pauvres en goûts. La surconsommation de tel produit industriel les leurrent (ainsi l’arôme synthétique de la vanille est moins complexe que son équivalent naturel). De plus, « la formation minoritaire et résiduelle de dérivés toxiques inattendus » perturbe le goût. Par voie de conséquence, « le nombre et la variabilité des papilles de ces enfants se restreignent, restent limités, refermant la fenêtre de détection des goûts possibles. C’est un peu comme quelqu’un qui ne posséderait que cent mots de vocabulaire : il serait incapable d’apprécier un livre, d’en appréhender l’essence et, de ce fait, il s’en désintéresserait. » Devenus adultes, ces enfants dont les papilles sont déficientes, recherchent ce qu’ils connaissent, des goûts artificiels ; s’ensuivent alors des déséquilibres alimentaires, sources de maladies.
Par ailleurs, les industriels sont amenés à « singer des arômes naturels vers lesquels notre inclination nous porte, pour donner de l’appétence à des produits gras et déséquilibrés, mais moins chers à produire. […] Faute d’une offre variée, les vrais goûts sont progressivement perdus. Cela peut aller jusqu’au rejet des goûts trop marqués, par exemple celui d’un lait ou d’un beurre fermiers. » La neutralité insipide des mêmes produits issus de l’industrie s’impose et « le processus d’habituation nivelle alors notre qualité de vie par le bas. » On l’aura compris : le goût s’éduque dès l’enfance et « il demande à être entretenu telle la condition physique d’un sportif. » D’ailleurs, pour G.E. Séralini, l’aire cérébrale centrale du goût est elle-même « en lien avec les souvenirs, la vision, les émotions, les états d’activité. » Pensons à Proust et à sa madeleine !
Ainsi le vrai plaisir de l’artisan du repas, ou du faiseur de pain ou de vin, la raison profonde pour laquelle il fait ce métier, c’est d’apporter du bonheur au convive. Or, dans cette quête, même en y amenant un grand soin, il est de plus en plus commun de se faire gruger sur la qualité chimique réelle des produits. Même le bon cuisinier se transforme alors en empoisonneur sans le vouloir, et le client, croyant aller à un repas de fête, s’expose à des maladies chroniques.
Alors la fête tourne à l’aigre et G.E. Séralini enfonce le clou : le carbone fossile du pétrole contamine le cycle de la vie. Les gaz des moteurs expulsent des résidus de pétrole, des microparticules non brûlées qui sont cancérogènes, des métaux toxiques, etc. Le carbone fossile du pétrole est intégré dans les plastiques ou les pesticides, début de la contamination du cycle de la vie. Il se lie à d’autres atomes pour former de nouveaux composés artificiels et sa biodégradabilité diminue fortement (plusieurs siècles pour un sac en plastique). « Le carbone du pétrole n’est pas réutilisable par les cellules vivantes. » Voir, par exemple, les HAP (hydrocarbures polycycliques aromatiques), véritables déchets, très toxiques, qui se volatilisent lors de la combustion du pétrole. Ces produits se répandent dans l’air et infestent les eaux maritimes et les eaux douces. A contrario, « le cycle naturel du carbone ne produit pas ces déchets en de telles quantités, puisque tout est recyclé. »
Ces résidus pétroliers, tel que le plastifiant dénommé bisphénol A, et ces autres polluants qui ressemblent si forts aux arômes que nous recherchons dans notre alimentation, nous les consommons involontairement et notre corps ne dispose pas des enzymes pour les digérer. « Les arômes artificiels produits à partir du pétrole ne font donc que tromper nos récepteurs, nos sensations. » Ces molécules étrangères dissoutes dans notre sang sont comme « du sable dans le moteur de la vie. » Ces produits polluants interfèrent dans notre corps comme des spams parmi nos courriels. Ils perturbent les communications intercellulaires qui nous font tenir debout (et qui sont bien plus développées que la totalité du web).
Nous consommons beaucoup de dérivés nocifs du pétrole. « Les bébés en ont longtemps absorbé via les tétines de biberon, qui contenaient du bisphénol A. On en ingère par les suintements d’une boîte de conserve ou de plastiques chauffés lorsqu’on prépare des aliments, lorsque les films plastique transparents restent trop longtemps en contact des aliments, lorsqu’une bouteille d’eau tiédit dans un véhicule en été. » Peintures murales, colles, cires et encres d’imprimerie fournissent aussi leurs lots de polluants. « Notre peau est une véritable éponge ! » et les métaux et autres résidus de combustion des moteurs à explosion suivent le même trajet.
Nous n’éliminons qu’en partie ces corps étrangers ; nous en retrouvons « coincés au fin fond de nos cellules, collés sur les gènes, dans le cerveau, les ovaires, les testicules ou les seins. […] Une mère en transmet même à son enfant en l’allaitant.» On sait aujourd’hui que ces produits sournois sont en augmentation croissante. « C’est pour cela que je parle de “poisons cachés”, car ils sont difficilement détectables et, de ce fait, très peu recherchés par la médecine moderne. »
Et G.E. Séralini d’insister : « Le lien entre ces pollutions alimentaires et les maladies chroniques est très peu étudié. A la morgue des hôpitaux ou lors d’autopsies, on ne mesure jamais, dans les organes, les taux de plastifiants, de cancérogènes ou de neurotoxiques. Alors qu’on va systématiquement rechercher les bactéries ayant provoqué une infection mortelle. »
Paracelse affirmait au XVIème siècle : « La dose fait le poison. » Nous savons aujourd’hui que la dose ne suffit pas pour caractériser le poison ; il convient aussi de prendre en compte la périodicité d’exposition à de faibles quantités ou bien la bioaccumulation de traces au cours du temps ou encore les effets différés de ces produits toxiques. Alors le poison pourra se révéler bien plus tard, après avoir accompli son œuvre.

